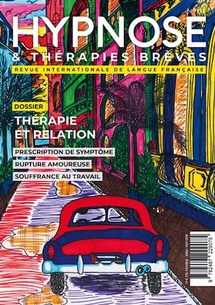« Oh ! on se calme, ne criez pas, du calme, j’ai dit. Arrêtez de vous bagarrer, ça va mal terminer, ça suffit ! » Les visages deviennent encore plus rouges, les mains tremblent et se transforment en poings, les yeux sont sur le point de quitter leur orbite, le pied est prêt pour le shoot. A l’intérieur, ça bouillonne, même les synonymes se battent pour la première place : colère, hargne, furie, rage. Non, il ne faut pas créer des conflits. Les conflits, c’est mauvais. Et ne commencez pas à m’énerver en me disant que j’aurais pu commencer ce « Quiproquo » sur un mode plus détendu, avec une certaine distance, sur un ton serein, posé. Non mais, ça va ? J’aimerais bien vous voir à ma place. Vous auriez déjà déchiré une dizaine de feuilles, versé votre violence sur toutes les touches du clavier et rempli la pièce de sonorités interdites d’écriture. « Bonjour, comment allez-vous ? » Je suis très content de pouvoir laisser glisser ma plume sur cette feuille pour vous partager quelques sympathiques réflexions sur un sujet du quotidien. C’est quelque chose que nous connaissons toutes et tous. Cela arrive de temps en temps ou même tous les jours. Nous adoptons alors des stratégies pour y faire face, ou faire avec, le fameux « coping », sans copier évidemment, et nous nous en sortons avec un agréable sentiment de réussite et de sérénité. Notre estime de soi, ou faut-il dire notre estime de nous ?, en sort renforcée. J’en reste à notre estime de soi, conçue en un seul mot comme le fait l’allemand. Il suffit de lier tous les mots en un seul, un peu comme en thaï où les lettres se suivent sans espace dans une phrase entière. Voyezvouscequejeveuxdiresinonvouspouvezlimaginer. En allemand, les mots liés entre eux ont en plus la particularité d’être mis à l’envers, pas dessus dessous, non, le premier devient le dernier et le dernier sera le premier. Divin, n’est-ce pas ? Estime de soi devient Selbstwertgefühl c’est-à-dire soivaleursentiment. Etrange, non ?
Vous comprenez maintenant pourquoi en français la psychanalyse freudienne remplit des pages et des pages quand le brave Sigmund posait un « simple » mot sur le papier. Cela doit avoir tellement rendu malades les traducteurs qu’ils en sont arrivés à traduire le « Es » par le « ça ». Ça alors ! il fallait le trouver. J’avoue que les traducteurs italiens ont été plus futés, astucieux, finauds ou malins, pour les amants de synonymes, en traduisant « Es » par « es ». Serait-ce plus clair ? Pas nécessairement. Cela évite néanmoins de s’embrouiller avec des phrases du type : que faire avec ça ?, mon ça, ça va pas bien. Ça je ne le comprends pas. « Docteur, mon surmoi est rigide, il maltraite mon moi et ça je ne le tolère pas. » Bref, ça risque de pousser à des jeux de mots en dessous du ça comme : ton surmoi n’est-il pas encore sous toit ? Toi, que fais-tu de ton moi qui n’est pas à toi vu que moi je n’ai pas de toi ? A part cet écart de contenu surgi probablement de mon inconscient, j’ai maintenant une devinette pour vous. A quoi fait référence le deuxième chapitre, celui qui commence avec le « Bonjour, comment allez-vous ? » écrit avec des caractères de la police « Courrier » ? A la réussite d’une recette, à l’accomplissement d’une tâche complexe, à une demande sur le lieu de travail, à une rencontre amoureuse, à l’interrogation pour le cadeau à faire pour un anniversaire ?
Vous avez sans doute bien d’autres réponses à cette devinette. Hélas, le « Quiproquo » n’est pas encore en ligne. Nous ne pouvons pas encore interagir en temps réel. Cela viendra et sonnera la fin du « Quiproquo ». Je vous entends déjà : « Ah ! non, je ne suis pas d’accord. C’est faux. Je dépose plainte pour diffamation... » Et ainsi de suite. La situation deviendrait aussitôt conflictuelle. Conflictuelle ? Conflit ? Qui de vous a répondu par ce dernier mot à la devinette ? Je prends le risque de la perspicacité : personne. Et pourquoi ? Par la simple constatation que dès que nos oreilles entendent le mot « conflit » ou nos yeux le détectent dans un texte, nous nous plongeons aussitôt dans un champ de bataille, sortons nos armes, préparons nos munitions et « bam ! » sur l’ennemi. Tout cela avec évidemment beaucoup de peur. Et qui ne l’aurait pas ? Mais qui a dit qu’il y a un ennemi ? Qui dit qu’il faut faire « bam ! » ? Nous avons alors déjà quitté le terrain du conflit pour nous situer sur le chemin de la solution choisie pour ce conflit. Bien sûr, l’étymologie du mot est en soi indicative : cum-fligere en latin ; cum : ensemble, et fligere : heurter, frapper. Cela devient se battre, lutter ensemble. Encore faut-il avoir renoncé à nos capacités de discernement des plans de signification, à notre liberté de pouvoir choisir, à notre possibilité de nous interroger sur les possibles. Alors le mot « conflit » ne peut que nous faire peur comme dans le…
Pour lire la suite...
Vous comprenez maintenant pourquoi en français la psychanalyse freudienne remplit des pages et des pages quand le brave Sigmund posait un « simple » mot sur le papier. Cela doit avoir tellement rendu malades les traducteurs qu’ils en sont arrivés à traduire le « Es » par le « ça ». Ça alors ! il fallait le trouver. J’avoue que les traducteurs italiens ont été plus futés, astucieux, finauds ou malins, pour les amants de synonymes, en traduisant « Es » par « es ». Serait-ce plus clair ? Pas nécessairement. Cela évite néanmoins de s’embrouiller avec des phrases du type : que faire avec ça ?, mon ça, ça va pas bien. Ça je ne le comprends pas. « Docteur, mon surmoi est rigide, il maltraite mon moi et ça je ne le tolère pas. » Bref, ça risque de pousser à des jeux de mots en dessous du ça comme : ton surmoi n’est-il pas encore sous toit ? Toi, que fais-tu de ton moi qui n’est pas à toi vu que moi je n’ai pas de toi ? A part cet écart de contenu surgi probablement de mon inconscient, j’ai maintenant une devinette pour vous. A quoi fait référence le deuxième chapitre, celui qui commence avec le « Bonjour, comment allez-vous ? » écrit avec des caractères de la police « Courrier » ? A la réussite d’une recette, à l’accomplissement d’une tâche complexe, à une demande sur le lieu de travail, à une rencontre amoureuse, à l’interrogation pour le cadeau à faire pour un anniversaire ?
Vous avez sans doute bien d’autres réponses à cette devinette. Hélas, le « Quiproquo » n’est pas encore en ligne. Nous ne pouvons pas encore interagir en temps réel. Cela viendra et sonnera la fin du « Quiproquo ». Je vous entends déjà : « Ah ! non, je ne suis pas d’accord. C’est faux. Je dépose plainte pour diffamation... » Et ainsi de suite. La situation deviendrait aussitôt conflictuelle. Conflictuelle ? Conflit ? Qui de vous a répondu par ce dernier mot à la devinette ? Je prends le risque de la perspicacité : personne. Et pourquoi ? Par la simple constatation que dès que nos oreilles entendent le mot « conflit » ou nos yeux le détectent dans un texte, nous nous plongeons aussitôt dans un champ de bataille, sortons nos armes, préparons nos munitions et « bam ! » sur l’ennemi. Tout cela avec évidemment beaucoup de peur. Et qui ne l’aurait pas ? Mais qui a dit qu’il y a un ennemi ? Qui dit qu’il faut faire « bam ! » ? Nous avons alors déjà quitté le terrain du conflit pour nous situer sur le chemin de la solution choisie pour ce conflit. Bien sûr, l’étymologie du mot est en soi indicative : cum-fligere en latin ; cum : ensemble, et fligere : heurter, frapper. Cela devient se battre, lutter ensemble. Encore faut-il avoir renoncé à nos capacités de discernement des plans de signification, à notre liberté de pouvoir choisir, à notre possibilité de nous interroger sur les possibles. Alors le mot « conflit » ne peut que nous faire peur comme dans le…
Pour lire la suite...
STEFANO COLOMBO Médecin psychiatre, psychologue diplômé consultant à la Faculté de Médecine de Genève (enseignement et supervision). Enseigne l’hypnose éricksonienne et la thérapie cognitive en France, Belgique, Suisse et Italie. Conférencier.
MOHAND CHÉRIF SI AHMED (alias Muhuc). Psychiatre en libéral à Rennes. Formation en hypnose et thérapies brèves. Pratique des thérapies à médiations artistiques. Utilise particulièrement le dessin humoristique de situation en thérapie (pictodrame humoristique). Illustrateur et intervenant par le dessin d’humour lors de rencontres et congrès médicaux.
MOHAND CHÉRIF SI AHMED (alias Muhuc). Psychiatre en libéral à Rennes. Formation en hypnose et thérapies brèves. Pratique des thérapies à médiations artistiques. Utilise particulièrement le dessin humoristique de situation en thérapie (pictodrame humoristique). Illustrateur et intervenant par le dessin d’humour lors de rencontres et congrès médicaux.
Commandez la Revue Hypnose & Thérapies Brèves 74
N°74 : Août / Sept. / Octobre 2024
La puissance thérapeutique de la relation humaine
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°74 :
Si la prise en compte du corps relationnel est au centre des changements en thérapie, cela implique pour le thérapeute d’être attentif au contexte relationnel favorisant les processus dissociatifs. Et pour favoriser les processus de réassociation, le thérapeute doit être en capacité de modifier les interactions qui entretiennent le problème.
. Nathalie Koralnik, dans un texte clair et pédagogique, nous montre comment la prescription du symptôme permet à des parents consultant pour des problèmes récurrents, avec une escalade symétrique de disputes et de crises, de retrouver une relation éducative positive, les parents pouvant s’investir dans un rôle de co-thérapeutes. L’approche stratégique, lorsqu’elle est pensée de manière coopérative, est vraiment un outil de choix pour sortir des impasses relationnelles.
. Delphine Le Gris nous parle de Mélanie, une jeune femme en grande souffrance après une rupture sentimentale où la relation de couple était depuis longtemps perçue comme maltraitante. En s’immergeant dans l’histoire de sa patiente, l’image de la mer et de l’eau est apparue, avec des vagues réparatrices permettant de retrouver les ressources enfuies et de rendre possible l’oubli des relations difficiles emportées au large. Nous voyons ainsi l’importance pour le thérapeute de se connecter à l’histoire racontée par le sujet pour ouvrir un imaginaire partagé, dans lequel la vie relationnelle va reprendre sa place.
. Michel Dumas évoque l’histoire de Stéphanie, confrontée à la déliquescence de la relation avec son mari qui, le plus souvent, met en scène sa tristesse et se réfugie devant son téléviseur. Elle ne parvient pas à aborder avec son conjoint cette situation où elle se sent de moins en moins aimée, car elle a peur d’un conflit qui provoquerait les conséquences qu’elle redoute. Après un recadrage : « si tu fais l’agneau, tu trouveras le loup qui te mangera », le thérapeute prescrit trois tâches stratégiques possibles pour sortir de ce cercle vicieux relationnel.
. Jérémie Roos nous raconte comment la situation bloquée de Zohra, attaquée par un chien, a pu évoluer grâce au sous-main de son bureau utilisé comme une scène imaginaire. Celle-ci permettra l’émergence de nouvelles formes relationnelles, ouvrant de nouveaux possibles grâce au soutien de la relation thérapeutique.
. Gérard Ostermann nous présente la synthèse effectuée par, Michel Ruel, à partir du travail de la CFHTB, sur l’utilisation de l’hypnose pour faire face à la souffrance au travail. Il rappelle l’importance de différencier le pré-effondrement de l’effondrement dans ces prises en charge. L’illustration clinique de la situation inquiétante d’un cadre d’entreprise subissant un début de désocialisation met en évidence l’intérêt du travail avec les métaphores pour retrouver des objectifs atteignables.
. Morgane Monnier, quant à elle, nous présente l’intérêt de l’hypnose et des thérapies brèves pour améliorer les prises en charge en psychomotricité.Dans le dossier thématique « Thérapie et relation ».
. Géraldine Garon et Solen Montanari mettent en lumière la puissance thérapeutique de la relation humaine lorsque le thérapeute et le patient entrent dans un processus de co-construction par un travail de questionnement permettant l’émergence d’un imaginaire partagé. Elles montrent, à travers les situations de Lou (qui se plaint de tics) et de Mathilde (présentant un excès de poids), comment l’externalisation nourrit le processus thérapeutique en favorisant l’accordage. Cet article décrit très bien l’apport de la TLMR à la mobilisation des ressources et au repositionnement du sujet. .
A partir de trois situations cliniques, Charlotte Thouvenot décrit avec précision l’importance de la carte du remembering pour retrouver une relation vivante et faire l’expérience de l’estime de soi.
. Olivier de Palézieux développe une meilleure compréhension du concept d’empathie, au centre de la relation. Pour cela, il en décrit l’historique et les variations de sens. Il illustre l’intérêt de sa réflexion à propos du cas de Lucas présentant un TSA (trouble du spectre autistique).
Vous retrouverez la chronique de Sophie Cohen sur une première consultation autour de la détresse conjugale et des réseaux sociaux, celle de Sylvie Le Pelletier-Beaufond « Passer les portes secrètes et apaiser les craintes ». Tandis que Stefano Colombo et Muhuc vous feront découvrir ce qui peut se cacher derrière la « peur du conflit ».
. Livres en bouche du mois.
La puissance thérapeutique de la relation humaine
Julien Betbèze, rédacteur en chef, nous présente ce n°74 :
Si la prise en compte du corps relationnel est au centre des changements en thérapie, cela implique pour le thérapeute d’être attentif au contexte relationnel favorisant les processus dissociatifs. Et pour favoriser les processus de réassociation, le thérapeute doit être en capacité de modifier les interactions qui entretiennent le problème.
. Nathalie Koralnik, dans un texte clair et pédagogique, nous montre comment la prescription du symptôme permet à des parents consultant pour des problèmes récurrents, avec une escalade symétrique de disputes et de crises, de retrouver une relation éducative positive, les parents pouvant s’investir dans un rôle de co-thérapeutes. L’approche stratégique, lorsqu’elle est pensée de manière coopérative, est vraiment un outil de choix pour sortir des impasses relationnelles.
. Delphine Le Gris nous parle de Mélanie, une jeune femme en grande souffrance après une rupture sentimentale où la relation de couple était depuis longtemps perçue comme maltraitante. En s’immergeant dans l’histoire de sa patiente, l’image de la mer et de l’eau est apparue, avec des vagues réparatrices permettant de retrouver les ressources enfuies et de rendre possible l’oubli des relations difficiles emportées au large. Nous voyons ainsi l’importance pour le thérapeute de se connecter à l’histoire racontée par le sujet pour ouvrir un imaginaire partagé, dans lequel la vie relationnelle va reprendre sa place.
. Michel Dumas évoque l’histoire de Stéphanie, confrontée à la déliquescence de la relation avec son mari qui, le plus souvent, met en scène sa tristesse et se réfugie devant son téléviseur. Elle ne parvient pas à aborder avec son conjoint cette situation où elle se sent de moins en moins aimée, car elle a peur d’un conflit qui provoquerait les conséquences qu’elle redoute. Après un recadrage : « si tu fais l’agneau, tu trouveras le loup qui te mangera », le thérapeute prescrit trois tâches stratégiques possibles pour sortir de ce cercle vicieux relationnel.
. Jérémie Roos nous raconte comment la situation bloquée de Zohra, attaquée par un chien, a pu évoluer grâce au sous-main de son bureau utilisé comme une scène imaginaire. Celle-ci permettra l’émergence de nouvelles formes relationnelles, ouvrant de nouveaux possibles grâce au soutien de la relation thérapeutique.
. Gérard Ostermann nous présente la synthèse effectuée par, Michel Ruel, à partir du travail de la CFHTB, sur l’utilisation de l’hypnose pour faire face à la souffrance au travail. Il rappelle l’importance de différencier le pré-effondrement de l’effondrement dans ces prises en charge. L’illustration clinique de la situation inquiétante d’un cadre d’entreprise subissant un début de désocialisation met en évidence l’intérêt du travail avec les métaphores pour retrouver des objectifs atteignables.
. Morgane Monnier, quant à elle, nous présente l’intérêt de l’hypnose et des thérapies brèves pour améliorer les prises en charge en psychomotricité.Dans le dossier thématique « Thérapie et relation ».
. Géraldine Garon et Solen Montanari mettent en lumière la puissance thérapeutique de la relation humaine lorsque le thérapeute et le patient entrent dans un processus de co-construction par un travail de questionnement permettant l’émergence d’un imaginaire partagé. Elles montrent, à travers les situations de Lou (qui se plaint de tics) et de Mathilde (présentant un excès de poids), comment l’externalisation nourrit le processus thérapeutique en favorisant l’accordage. Cet article décrit très bien l’apport de la TLMR à la mobilisation des ressources et au repositionnement du sujet. .
A partir de trois situations cliniques, Charlotte Thouvenot décrit avec précision l’importance de la carte du remembering pour retrouver une relation vivante et faire l’expérience de l’estime de soi.
. Olivier de Palézieux développe une meilleure compréhension du concept d’empathie, au centre de la relation. Pour cela, il en décrit l’historique et les variations de sens. Il illustre l’intérêt de sa réflexion à propos du cas de Lucas présentant un TSA (trouble du spectre autistique).
Vous retrouverez la chronique de Sophie Cohen sur une première consultation autour de la détresse conjugale et des réseaux sociaux, celle de Sylvie Le Pelletier-Beaufond « Passer les portes secrètes et apaiser les craintes ». Tandis que Stefano Colombo et Muhuc vous feront découvrir ce qui peut se cacher derrière la « peur du conflit ».
. Livres en bouche du mois.